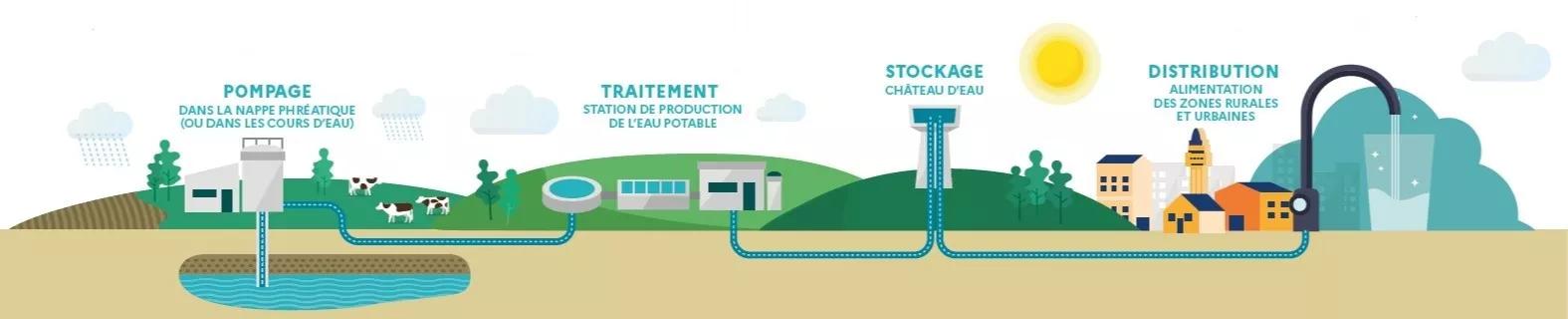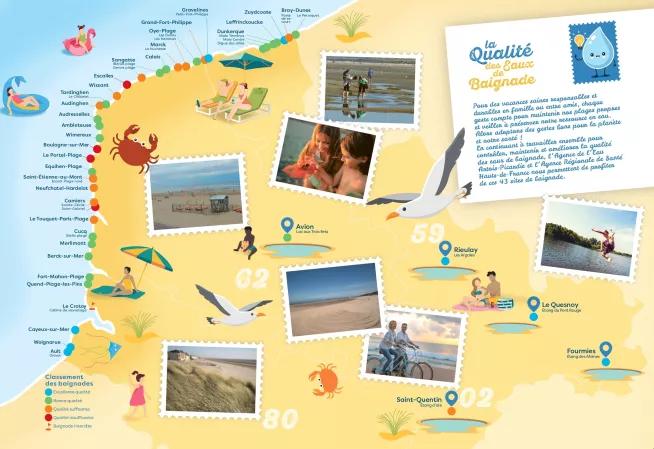Pour mener à bien la mise en place des PGSSE, l’ARS Hauts de France accompagne tous les acteurs du territoire via différentes actions :
Mise à disposition d’outils d'information et de communication :
- Envoi d’une newsletter semestrielle avec les actualités et les actions menées par l’ARS sur les PGSSE
- Newsletter 5 – décembre 2025, avec le comité technique régional PGSSE du 20/11/25, les actus de la communauté PGSSE : atelier d’échange sur l’autosurveillance et fiches retour d’expérience en région, le résumé PGSSE, les dernières infos connues sur la définition des « captages sensibles ».
- Newsletter 4 – juin 2025, avec les dates des formations PGSSE dispensées en 2025 par le CNFPT, les aides financières des agences de l’eau pour les PGSSE, un retour de l’atelier d’échange sur l’identification et la cotation des risques, la définition des « captages sensibles ».
- Newsletter 3 - décembre 2024, avec un retour sur la réunion de sensibilisation PGSSE dans le Pas-de-Calais, les évolutions réglementaires qui incombent dorénavant aux PRPDE et l’autosurveillance de la qualité de l’eau à mettre en place par la PRPDE.
- Newsletter 2 - juillet 2024, avec un rappel des étapes du PGSSE, un article sur la communauté PGSSE, un retour sur la réunion de sensibilisation PGSSE dans l’Aisne, les dates des formations PGSSE dispensées en 2024 par le CNFPT.
- Newsletter 1 - janvier 2024, avec un point réglementaire PGSSE et un bilan des actions 2020-2022, des réunions techniques et de l’enquête sur le déploiement des PGSSE en HDF.
- 3 vidéos de témoignage de PRPDE de la région qui se sont déjà lancées dans la démarche PGSSE
Organisation de sessions d’acculturation (sensibilisation) et de formations
- à destination des PRPDE de l’ensemble des départements de la région
- à destination des bureaux d’études
En parallèle, l’ARS se mobilise pour accompagner les PRPDE dans l’élaboration de leur PGSSE (participation au COPIL de lancement, suivi des conclusions des études…).
Focus sur les sessions d'acculturation des PRPDE de la région
Ces sessions visent à faire adhérer les PRPDE à la démarche PGSSE. Elles sont composées de la présentation d'un retour d’expérience sur un incident sanitaire afin de mettre en évidence ce qui aurait pu être anticipé grâce à un PGSSE, ainsi que d'une présentation du contexte réglementaire, avant d’aborder une partie plus spécifique aux PGSSE.
Des interventions des Agences de l'eau Artois-Picardie & Seine Normandie ont également lieu au cours de ces sessions afin de présenter le dispositif d’aide financière.
Focus sur les formations à destination des collectivités de la région
A la demande de l’ARS, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) organise deux types de formations relatives à l’élaboration d’un PGSSE à destination des agents territoriaux de la région :
- formations PGSSE d’une journée pour les collectivités souhaitant se faire accompagner par un bureau d’études ou une autre structure de maîtrise d’œuvre, pour l’élaboration de leur PGSSE ;
- formations PGSSE de deux jours pour les collectivités souhaitant élaborer elles-mêmes leur PGSSE.
Des formations destinées aux agents territoriaux de la région seront organisées début 2025 :
- Formation d’une journée : s'inscrire (9 mars 2026 à Amiens et 10 mars 2026 à Lille)
- Formation de 2 journées : s'inscrire (4-5 mai 2026 à Arras)
A noter que le nombre maximum de stagiaires sera de 20 personnes par formation et que le nombre de places pour une même structure sera limité.
Focus sur les sessions de formation des bureaux d’étude
Outre une réunion de sensibilisation des bureaux d’études en janvier 2022, l’ARS Hauts-de-France a organisé, en partenariat avec le pôle AQUANOVA, une formation les 10 et 11 mai 2022 afin de former les bureaux d’étude à la démarche PGSSE.
Objectifs :
• Connaître les évolutions réglementaires sur le sujet
• Connaître les principes de la sécurité sanitaire des eaux et la démarche PGSSE
• Comprendre les différentes étapes de l’élaboration d’un PGSSE
• Être capable de mettre en place une démarche PGSSE via une étude de cas
• Comprendre les responsabilités des différents acteurs et notamment le rôle d’un Bureau d'études.