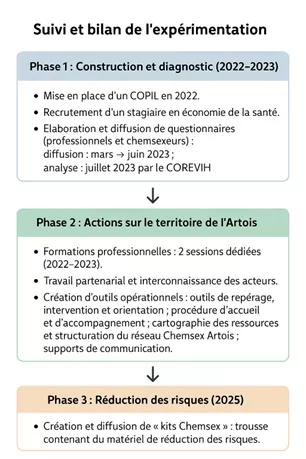Le phénomène du « chemsex » est apparu en France au début des années 2010 et a connu un essor depuis la crise Covid, notamment durant les périodes de confinement. Plusieurs facteurs contribuent à cette évolution complexe :
- Évolution des modes de vie et des pratiques sexuelles : la quête de nouvelles expériences et le souhait d’explorer ses désirs de manière libre et assumée ;
- Accessibilité accrue des substances : apparition de nouveaux produits de synthèse comme les cathinones (la 3MMC en particulier) ou le GHB/GBL, plus abordables et faciles à se procurer ;
- Influence des réseaux sociaux et des applications de rencontre géolocalisées :
o Facilitation de l’accès aux substances via internet, avec une diversité d’acteurs et des modes de vente variés ;
o Mise en relation des personnes, échanges d’informations et organisation des rencontres via des plateformes numériques et les applications de rencontres ; - Recherche de lien social et d’appartenance : dans un contexte parfois de stigmatisation et de marginalisation, certaines personnes trouvent dans ces pratiques un espace d’expression, de liberté et d’intégration dans une communauté.
Au-delà de ces facteurs, la diversité est un élément central du phénomène :
- Profils très variés : Les participants viennent de tous horizons (âge, profession, niveau de revenus, parcours de vie). On y trouve aussi bien des chefs d’entreprise, cadres, médecins que des employés, ouvriers, artisans, étudiants, demandeurs d’emploi ou personnes récemment arrivées en France. Ces différences peuvent engendrer des formes d’échanges économiques liés à la participation aux sessions (partage des frais, hébergement, consommation) ;
- Organisation des sessions : Si le chemsex peut parfois se limiter à une rencontre entre deux participants, certaines rencontres peuvent durer plusieurs jours et réunir un grand nombre de personnes (souvent via des applications de rencontre) qui se renouvellent régulièrement ;
- Trajectoires de consommation : Certains connaissent bien les substances qu’ils consomment depuis longtemps dans un contexte festif et maîtrisent leurs effets, tandis que d’autres expérimentent ces drogues pour la première fois, avec des niveaux de connaissance variables concernant les risques (dépendance aux produits, impacts sur la vie sociale et la vie sexuelle, IST, troubles psychiatriques, blessures, overdose) et les moyens de les réduire.
La prévalence du chemsex reste difficile à estimer précisément. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) estime que 13 à 14 % des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) y ont recours. Cette pratique semble également présente dans d’autres groupes, même si les chiffres restent encore mal évalués.